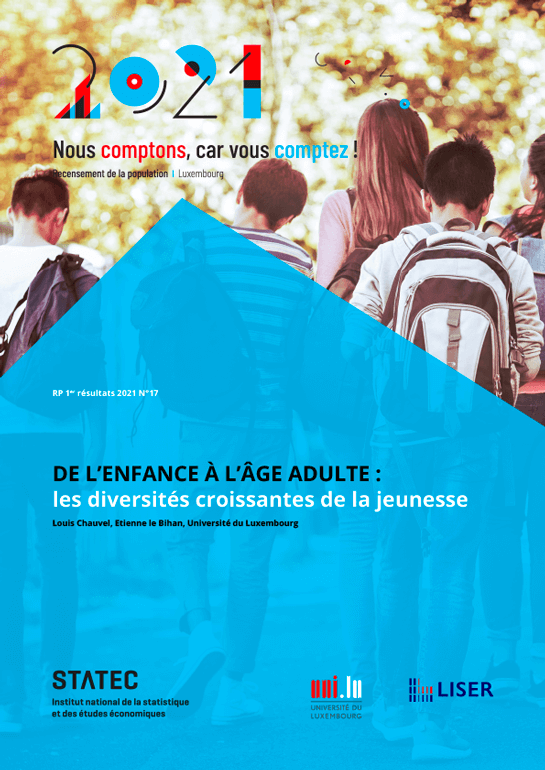De l’enfance à l’âge adulte : les diversités croissantes de la jeunesse
25, 30, 40 ou 50 ans… Devenir adulte est de plus en plus un concept en perpétuelle transition.
Enfants et jeunes adultes, femmes et hommes, diplômés et sans-diplôme, natifs et immigrés, groupes linguistiques et culturels… tout contribue à faire des jeunesses au Luxembourg un phénomène aux multiples facettes.
La jeunesse, autrefois définie jusqu'à 25 ans, est ici élargie jusqu'à 39 ans afin de mieux refléter la diversité des réalités.
Une jeunesse qui se
diversifie dans le temps
Entre 2011 et 2021, la population du Luxembourg a connu une forte dynamique migratoire, avec une augmentation notable des personnes nées à l’étranger, passant de 38.9% à 49.2 % de la population. La population totale a ainsi augmenté de plus de 130 000 personnes, soit une hausse de 25 %.
Cette évolution a aussi touché les jeunes. La population des moins de 40 ans a augmenté en nombre, avec une croissance de près de 62 000 personnes. Cependant, en raison du vieillissement de la population, la proportion des jeunes dans la population totale a légèrement diminué, passant de 51.4 % en 2011 à 50.5 % en 2021.
Concernant les moins de 20 ans, l’impact migratoire direct est plus faible. En 2021, moins d’un quart des jeunes de moins de 20 ans (23.9 %) sont nés à l’étranger, la majorité est née au Luxembourg. Cela dit, une part importante de ces jeunes est issue de familles immigrées. En 2021, 68.9 % des moins de 20 ans avaient une mère née à l’étranger, contre 60.2 % en 2011.
Parmi les moins de 40 ans, la population née au Luxembourg a fortement augmenté en nombre, passant de 166 384 en 2011 à 184 984 en 2021. Cependant, comme la croissance des jeunes nés à l’étranger est plus rapide, la part des natifs du Luxembourg a diminué, passant de 63.1 % à 56.8 %.
Les pays d’origine des jeunes révèlent des changements significatifs dans les flux migratoires. En particulier, la population d’origine portugaise, bien que toujours nombreuse, a diminué, notamment chez les enfants de moins de 10 ans, dont le nombre a été réduit de moitié. À l’inverse, le nombre de jeunes nés en France et en Italie a fortement augmenté. La plus grande croissance provient des jeunes nés en dehors des 15 principaux pays de naissance des résidents.
Cette évolution souligne un défi majeur : préparer l’accueil, en particulier scolaire, d’une population jeune de plus en plus diverse, dépassant les frontières des pays voisins et même de l’Europe.
Graphique 1 : Nombre de jeunes selon l’âge et le pays de naissance en 2011 et en 2021 - Source : STATEC, RP2021
Cette diversification croissante de la jeunesse au sens large se mesure aussi à la complexité du lien entre lieu de naissance et nationalité des jeunes : beaucoup de jeunes, même nés au Luxembourg, ne sont pas Luxembourgeois par leur nationalité. L’évolution du système légal d’accès à la nationalité luxembourgeoise a permis toutefois à un plus grand nombre de jeunes nés de mère étrangère de devenir Luxembourgeois, comme le montre la forte croissance de 64.2% à 85.3% (de 2011 à 2021) de l’accès à la nationalité luxembourgeoise des 20-39 ans nés au Luxembourg et dont la mère est née à l’étranger.
L’entrée dans la vie active
L’entrée dans la vie active est marquée par une succession d’étapes : d’abord la sortie des études, puis la transition vers la population active, et l’obtention d’un emploi proprement dit. En 2021, l’âge de fin d’études médian des hommes est situé autour de 22.5 ans, contre 23.5 pour les femmes, terminant donc leurs études plus tard.
Au-delà de 30 ans, seuls 3% des hommes n’entrent pas dans la vie active, notamment pour des raisons médicales ou d’invalidité ; pour les femmes, les 10% de femmes inactives observées au-delà de l’âge de 30 ans concernent avant tout des mères de famille se consacrant à la garde de leurs enfants, un choix plus fréquemment observé dans les familles d’expatriés vivant au Luxembourg.
De l’enfance à l’âge adulte :
types de ménages selon l’âge
Aujourd’hui, malgré la complexification observée des formes de ménages, les enfants vivent le plus souvent dans un ménage formé par un couple. 18.3% de la tranche d’âge des 15 à 19 ans vit dans une famille monoparentale et 6.1% dans un ménage multi-noyaux caractérisé par la présence d’autres adultes sans lien familial.
Passé l’âge de 20 ans, les transitions selon les types de ménage s’accélèrent avec l’entrée en indépendance des enfants. On note ainsi une diversification des types de ménages en particulier entre les âges de 25 et 34 ans, avec une forte présence de personnes seules ou vivant en colocation étudiante ou de jeunes travailleurs ainsi qu’une croissance des couples sans enfant. Au-delà de l’âge de 30 ans, le couple avec enfant devient progressivement majoritaire, même si les autres modes de vie se maintiennent.
Graphique 2 : Types de ménage des jeunes selon l’âge en 2021 (%) - Source : STATEC, RP2021
Du logement indépendant à la vie en couple,
et la naissance des enfants
Les étapes de la vie familiale sont plus complexes et moins linéaires que celles de la vie professionnelle. La séquence classique — quitter le foyer parental, vivre en couple, puis avoir un ou plusieurs enfants — suit une logique globale, mais les transitions entre ces étapes sont moins étroitement liées que celles menant à l’emploi.
En matière familiale, les hommes prennent davantage de retard par rapport aux femmes. Ainsi, l’âge médian pour quitter le foyer parental est de 26 ans pour les femmes et 27 ans pour les hommes. La moitié des femmes vit en couple à 28 ans, contre 31 ans pour les hommes. Enfin, l’âge médian pour avoir au moins un enfant à charge est de 32.5 ans pour les femmes et de 35 ans pour les hommes.
Différences culturelles dans l’indépendance professionnelle et familiale : précocité des lusophones
Les transitions vers l’indépendance professionnelle et familiale varient selon les groupes culturels au Luxembourg, définis ici par leur langue principale. Deux étapes principales permettent ces comparaisons : « avoir un emploi » (mesuré entre 22 et 26 ans) et « avoir un enfant ou plus à charge » (mesuré entre 33 et 37 ans).
Globalement, les hommes accèdent légèrement plus tôt à l’emploi que les femmes, sauf chez les germanophones, où des études plus longues retardent leur entrée sur le marché du travail. En revanche, les femmes franchissent plus rapidement le seuil de la parentalité, avec des écarts plus prononcés entre hommes et femmes sur cet indicateur.
Les lusophones se distinguent par une précocité marquée sur les deux critères. À 22-26 ans, 76.5% des hommes lusophones sont en emploi, contre seulement 42.8% des germanophones. De même, chez les femmes de 33-37 ans, 78.1% des lusophones ont au moins un enfant à charge, contre 50.1% des italophones.
Graphique 3 : Comparaison du seuil « a un emploi » parmi les jeunes de 22 à 26 ans et « a un enfant » parmi les 33 à 37 ans selon la langue principale parlée en 2021 - Source : STATEC, RP2021
En résumé, les populations lusophones affichent une avance significative dans l’accès à l’emploi et à la parentalité, tandis que les germanophones accusent un léger retard sur ces deux fronts.
Report des seuils d’entrée dans la vie professionnelle
et familiale entre 2011 et 2021
Entre 2011 et 2021, l’entrée dans la vie professionnelle et familiale au Luxembourg s’est globalement décalée à des âges plus tardifs. Les transitions vers l’emploi ont lieu environ un an plus tard, tandis que l’arrivée du premier enfant est repoussée de deux ans.
Pour l’accès à l’emploi, les jeunes commencent à travailler autour de 22 ou 23 ans, avec une transition désormais plus rapide et homogène entre les premiers et les derniers à entrer sur le marché du travail. Ce changement est particulièrement notable chez les femmes, pour qui le modèle traditionnel de mère au foyer est devenu marginal.
En revanche, la parentalité est non seulement retardée — les premières étapes de cette transition se situant maintenant au-delà de 30 ans — mais aussi plus étalée dans le temps. Cela reflète un calendrier moins structuré et une éventuelle baisse de la proportion de personnes franchissant ce seuil.
Ces tendances mettent en évidence des évolutions sociétales marquées par une normalisation du parcours professionnel et une plus grande flexibilité dans les trajectoires familiales.
Entrée dans la vie adulte :
disparités géographiques au Luxembourg
L’analyse des seuils d’entrée dans la vie adulte, à travers l’accès à l’emploi (22-26 ans) et à la parentalité (33-37 ans), révèle des disparités géographiques au Luxembourg.
Accès à l’emploi
La précocité de l’entrée en emploi est surtout observée dans les communes où les jeunes suivent des études plus courtes. Ainsi, les communes rurales du nord, du sud, et de l’est affichent une transition plus rapide vers l’emploi. À l’inverse, les communes proches de la capitale, où le niveau d’éducation est plus élevé, voient les jeunes entrer sur le marché du travail plus tardivement.
Accès à la parentalité
Pour le seuil « avoir un enfant », les communes caractérisées par une forte proportion de maisons individuelles et un habitat de densité intermédiaire sont les plus précoces. Ces zones, où le rapport qualité-prix du logement reste attractif, favorisent l’installation des familles. Par contraste, dans la capitale et ses environs immédiats, l’entrée dans la parentalité est plus tardive, voire difficile.
En somme, ces dynamiques mettent en évidence un effet centrifuge autour de la capitale : l’installation dans la vie adulte, qu’elle soit professionnelle ou familiale, y est retardée par rapport aux zones rurales et périurbaines.
Carte 1 : Pourcentage de personnes « ayant un emploi » parmi les jeunes de 22 à 26 ans (A) et de personnes « ayant un enfant » au moins parmi les 33 à 37 ans (B) en 2021 - Source : STATEC, RP2021
En savoir plus sur les diversités croissantes de la jeunesse au Luxembourg
Suite des résultats
Dans les mois à venir, diverses publications destinées au grand public, mais aussi au public spécialiste des questions démographiques, seront réalisées. Parallèlement, des tableaux statistiques, portant sur les différents thèmes du recensement, seront publiés sur le Portail des statistiques.
Pourquoi le recensement
est-il important ?
Les résultats du recensement constituent une information essentielle pour la prise de décision en matière de politique publique.
Les données des recensements facilitent les prévisions des besoins en matière d’aménagement du territoire, d’écoles, de crèches, d’hôpitaux, de maisons de retraite et de soins, de logements, etc.
Dernière modification le